
Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes
Le CERDACC édite deux revues numériques gratuites: le Journal des Accidents et des Catastrophes (JAC) et Risques, Etudes et observations (RISEO)
PRÉSENTATION DU LABORATOIRE
Les catastrophes et les accidents collectifs rythment, malheureusement, la vie des sociétés modernes. Après l’événement, tous les acteurs, institutionnels ou non, sont confrontés à des logiques différentes et à des approches inhabituelles nécessitant l’élaboration de dispositifs spécifiques de nature à répondre aux attentes légitimes des victimes et de leurs ayants droit. Ce constat a amené à la création du CERDACC (Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes) en 1995. Ce laboratoire de recherche, rattaché à l’Université de Haute-Alsace, avait pour objet initial d’étudier les dispositifs de toute nature (juridique, judiciaire, administrative) mis en place après la survenance de catastrophes et d’accidents collectifs.
Tout en restant fidèle à son champ de réflexion initial, le CERDACC a élargi son spectre de recherche, pour y intégrer les thématiques du Risque. Ainsi, au regard de l’importance de plus en plus grande de la notion de risque dans la société civile et dans les réflexions intellectuelles (notamment juridiques, politiques et économiques), le CERDACC est devenu, en 2010, le Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes.
Désormais, il vise à :
– aborder les risques collectifs dans leur diversité (technologiques, industriels, nucléaires, naturels, sanitaires, climatiques, liés à la santé et aux activités humaines) ;
– développer une analyse de la prévention des risques, notamment sous l’angle de la sécurité, de la conformité, de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et de la transition écologique et environnementale ;
– étudier la réparation des dommages subis, sous l’angle des mécanismes assurantiels, du recours à la solidarité nationale et des actions visant à établir les responsabilités administratives, civiles et pénales.
Le CERDACC regroupe des enseignants chercheurs sur trois sites géographiques (IUT de Colmar, Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de Mulhouse- Campus Fonderie, IUT de Mulhouse).
Ses travaux de recherche s’inscrivent dans une démarche de diffusion du savoir. En premier lieu, les recherches menées par les membres du CERDACC sont présentées aux étudiants. En effet, les quatre parcours de Masters Droit ont été conçus en synergie avec les différents axes portés par le CERDACC, par le biais d’unités d’enseignements transversales en droit des risques (prévention des risques, gestion des risques et droit des risques). En second lieu, le CERDACC diffuse deux revues numériques, l’une sous la forme d’un journal mensuel, le JAC (le Journal des Accidents et des Catastrophes), l’autre sous les traits d’une revue universitaire biannuelle, RISEO (Risques, Etudes et Observations)
MASTER DROIT A LA FSESJ DE MULHOUSE :
Le Master Droit est composé de quatre parcours déclinés sur les deux années du diplôme :
– Professions juridiques et judiciaires
COLLOQUE INTERNATIONAL
19 septembre 2025
Les responsabilités du fait d’autrui
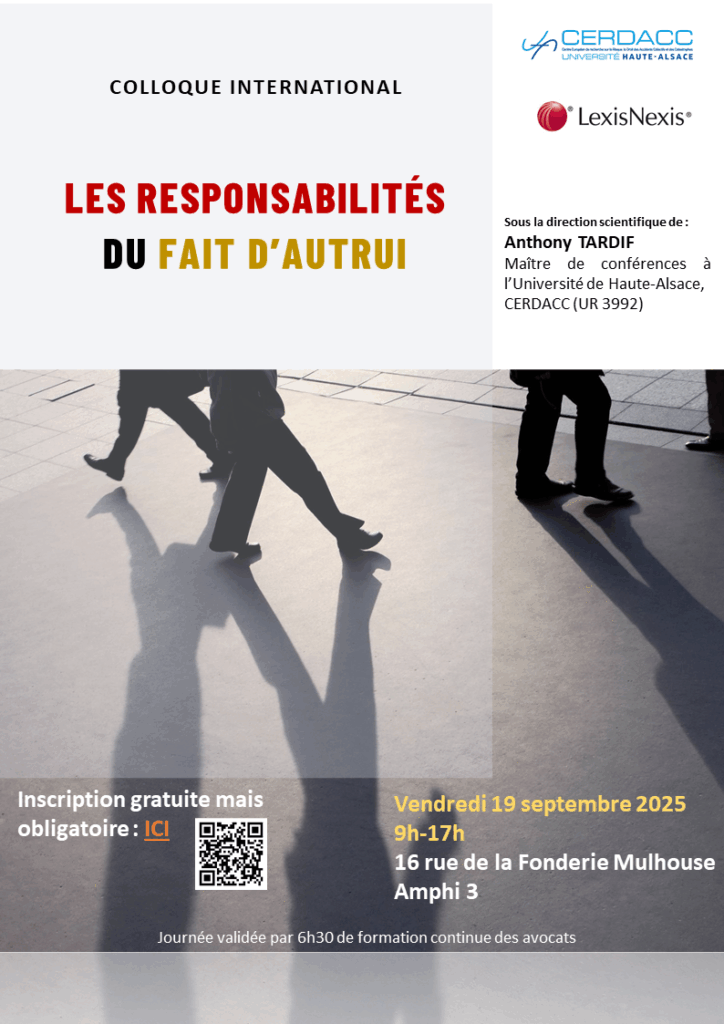
Lieu : FSESJ, 16 rue de la Fonderie Mulhouse
Inscription gratuite mais obligatoire : https://forms.gle/ZJm3abSLtDYRvueu6
——————————————————————————————————————–
COLLOQUE
« RISQUES ET TERRITOIRES, ENTRE RÉSILIENCE ET INNOVATION »
Le CERDACC, 30 ans après

Accès gratuit sur inscription, possibilité d’accéder à la manifestation à distance.
Lien vers le formulaire : https://forms.gle/MFLPFNjp59PXyQsC7
——————————————————————————————————————–
Les rendez-vous du risque
« Le Risque et l’Université »
Colmar, Campus du Grillenbreit, Bât.F, amphi 14 et en ligne
Inscription gratuite mais obligatoire : https://forms.gle/iMiMXaux4crrXnwV8
Le progamme
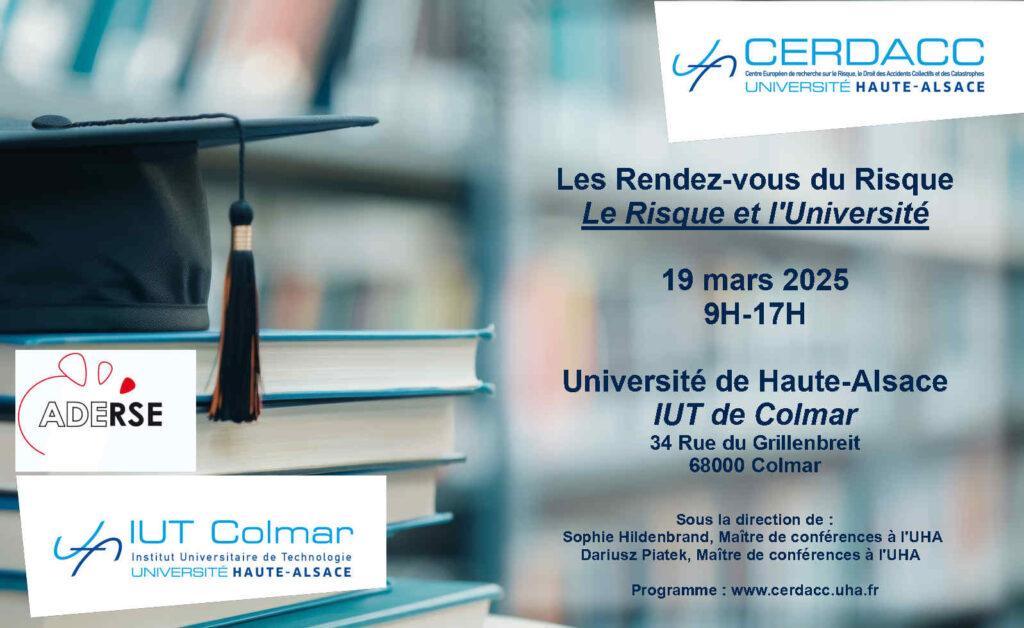
——————————————————————————————————————–
Rencontres PJJ « La Justice restaurative »
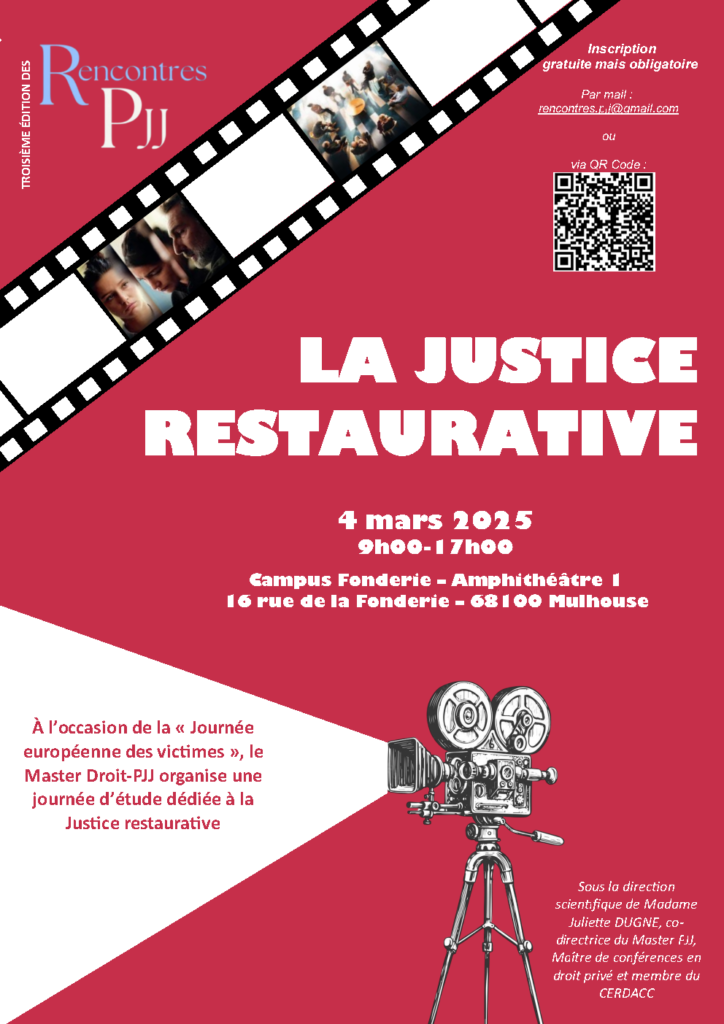
L’affiche et le programme ay format PDF
————————————————————————————————————–
Conférence
« La transition écologique et la lutte pénale contre les risques d’infiltrations mafieuses à la lumière du droit italien »
Amphi 1, Fonderie, de 17h30 à 19h.
Inscription gratuite mais obligatoire : nathalie.arbousset@uha.fr

——————————————————————————————————————–
Les Entretiens du Grillenbreit, 7 ème édition, 29 novembre 2024
10h/16h, Colmar et à distance

Inscription gratuite : cliquez sur le lien
—————————————————————————————————————
Colloque international « L’eau-un risque ? », Mulhouse, Campus Collines, amphi nord
14 novembre 2024 9h/17h
Inscription/Registration : Formulaire

LES INCERTITUDES DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. QUELS RISQUES? QUELLES OPPORTUNITES ?
D. Piatek (ss la dir.) LexisNexis, 2024
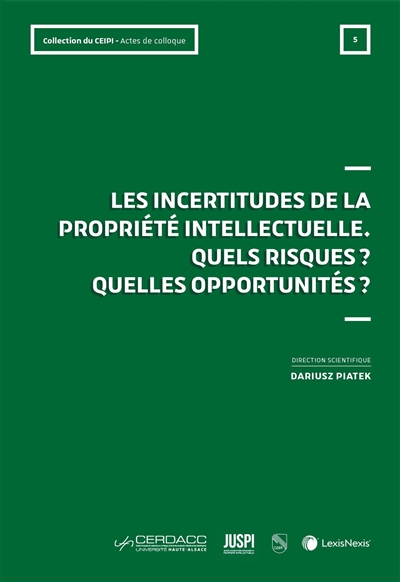
« RISQUES ET VOYAGES »
Le programme et les modalités d’inscription
——————————————————————————————————————-
RENDEZ-VOUS DU RISQUE « Risque, environnement, éthique et care »
20 mars 2024 Mulhouse fonderie 14h/17h
ENTRETIENS DU GRILLENBREIT 24 novembre 2023
L’eau et le nucléaire. Une approche juridique et sociopolitique
Colloque international « Présomptions et responsabilités »
22 septembre 2023 Le Programme
LES RENDEZ-VOUS DU RISQUE « RISQUE ET SANTÉ »
14 mars 2023, FSESJ, Mulhouse
LE PROGRAMME ICI
JOURNÉE D’ÉTUDE « BILAN ET PERSPECTIVES DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES UNIVERSITÉS »
6 décembre 2023, Paris
COLLOQUE
LES INCERTITUDES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Quels risques ? Quelles opportunités ?
2 février 2023 Mulhouse (Campus la Fonderie)
LE PROGRAMME
ENTRETIENS DU GRILLENBREIT (5ème édition)
25 novembre 2022, Campus du Grillenbreit à Colmar
Europe et nucléaire : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives
ENTRETIENS DU GRILLENBREIT, 3 décembre 2021
« Démantèlement et culture : déconstruire un objet nucléaire »
Les travaux du matin : https://www.youtube.com/watch?v=K8H0N-k3gb0
Les travaux de l’après-midi : https://www.youtube.com/watch?v=EOkl4pA6ggc
En complément :
VertigO Hors-série 35 | octobre 2021 Approches interculturelles des identités nucléaires autour d’un démantèlement (Valentine ERNE-HEINTZ, sous la dir.) : https://journals.openedition.org/vertigo/32047
« 25 ans du CERDACC »
Présentation du CERDACC sur YouTube
-
Table-Ronde du 9 février 2021 : Risques et Santé : de la santé publique à la santé au travail
Présentation par les participants de la Table-Ronde JAC n° 202
Compte-rendu de la Table-Ronde JAC n°204
-
Table-Ronde du 21 mai 2021 : Accidents collectifs et catastrophes : questions de droit comparé et européen
Publication des actes dans Riséo 2022-1
-
Table-Ronde du 21 mai 2021 : Risque, effondrement, catastrophisme. C’est la fin du monde ! Fake news ?
Publication des actes dans Riséo 2022-1 et diffusion des propos introductifs de M. Lagadec sur YouTube
-
Table-Ronde du 18 juin 2021 : La prise en compte des risques collectifs liés aux vulnérabilités durant la pandémie de Covid-19
Les interventions sur YouTube
LES ENTRETIENS DU GRILLENBREIT 2020
Les dix ans de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Certaines interventions ont été mises en ligne sur la chaine YouTube du CERDACC (CLIQUEZ ICI).
LES RENDEZ-VOUS DU RISQUE LE RISQUE COVID-19
A voir sur notre chaîne YT : https://www.youtube.com/channel/UCUR_FAAyvX2oYeXvBRy4Y_Q
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
Visualiser les CV des membres en cliquant sur l’icone ![]() .
.
